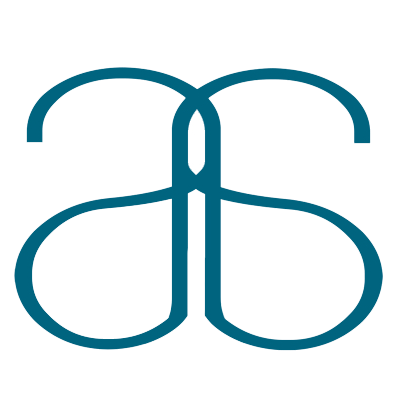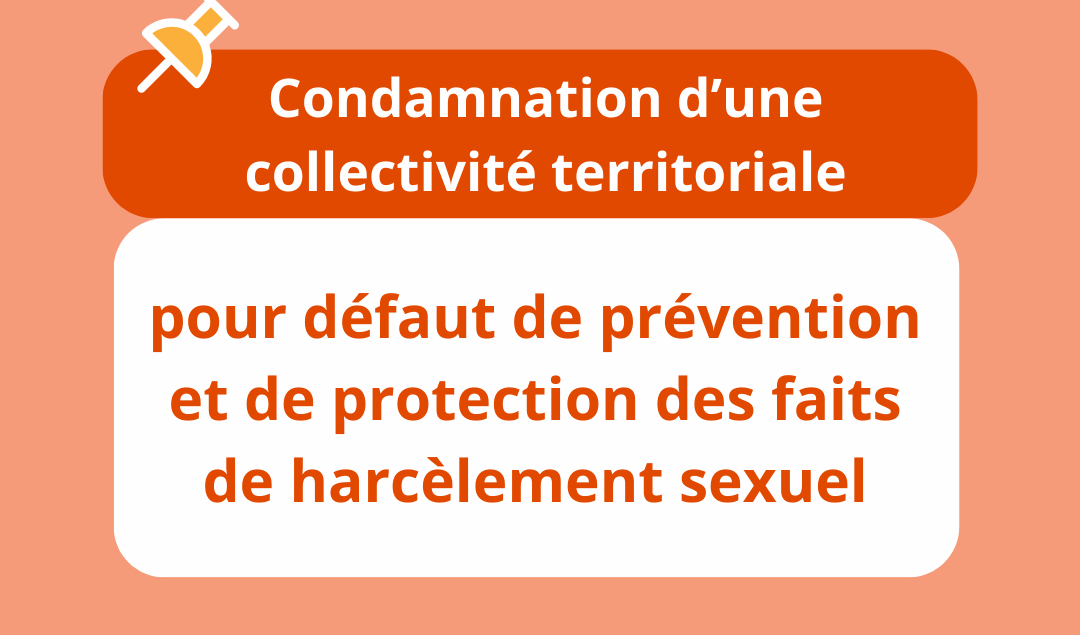Condamnation d’une collectivité territoriale pour défaut de prévention et de protection des faits de harcèlement sexuel
La condamnation d’une collectivité territoriale pour défaut de prévention et de protection des faits de harcèlement sexuel
—
Commentaire de l’arrêt CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 8 avril 2025, 23BX01106
Dans un arrêt du 8 avril 2025, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a retenu qu’une collectivité publique qui ne met pas en place les mesures nécessaires pour prévenir des faits de harcèlement sexuel et protéger l’agent de ces faits engage sa responsabilité.
Une adjointe administrative territoriale de 2ème classe à la collectivité territoriale de Martinique a présenté une demande indemnitaire en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’absence de mesures prises par son employeur pour prévenir et la soustraire au harcèlement sexuel dont elle expose avoir été victime de la part d’un collègue affecté dans le même service.
En effet, ce collègue a tenu, à plusieurs reprises, dans son bureau, des propos à caractère sexuel ou sexiste, a mimé des actes sexuels, évoqué avec insistance son physique et ses tenues vestimentaires et lui a envoyé sur son téléphone des messages à connotation sexuelle, alors même qu’elle avait exprimé son désaccord. Plus tard, il lui a également embrassé l’épaule. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par l’administration.
Elle a, par ailleurs, porté plainte et l’agent a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à la privation de droit d’éligibilité pour une durée de deux ans, pour des faits de harcèlement sexuel commis entre le 1er mai 2019 et le 17 décembre 2019.
L’adjointe administrative a saisi le tribunal administratif de la Martinique pour que la collectivité soit condamnée à l’indemniser de son préjudice lié au harcèlement sexuel. Le tribunal a rejeté sa demande, elle a alors relevé appel du jugement.
Dans cette décision, la responsabilité de la collectivité de Martinique est retenue sur deux fondements : son obligation de prévention (I.) et son obligation de protection (II.).
I. L’obligation de prévention pesant sur l’administration
La cour rappelle tout d’abord les dispositions légales qui instaurent une obligation de prévention pour la collectivité de Martinique.
En effet, l’employeur public est tenu à une obligation de mener des actions de prévention des risques professionnels.
Le Code général de la fonction publique indique à l’article L. 136-1 que l’administration doit assurer aux agents « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique ».Dans chaque versant de la fonction publique, les règles qui s’appliquent en matière d’hygiène et de sécurité au travail sont celles définies par le code du travail. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre des « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ». Ces mesures comprennent des actions de prévention ; des actions d’information et de formation et aussi la mise en place d’une organisation de moyens adaptés.
La carence de l’administration engage sa responsabilité.
En effet, la carence de l’administration qui ne prend aucune mesure adéquate pour prévenir les faits de harcèlement sexuel ou faire cesser les agissements signalés dont elle a pu vérifier la matérialité, constitue une faute de service susceptible d’engager sa responsabilité devant le juge administratif (CAA Paris, 28 mars 2017, n° 16PA03037).
En l’espèce, selon la plaignante, la collectivité de Martinique n’a mis en place aucune action d’information et de formation sur les risques professionnels alors qu’elle avait déjà effectué un premier signalement pour alerter sa hiérarchie sur le harcèlement sexuel dont elle était victime. La cour retient que l’administration ne rapporte aucun élément permettant de constater que de telles actions aient été mises en place.
Par ailleurs, un audit de la direction du service dans lequel travaille la plaignante a été conduit par un prestataire externe en 2020. Les conclusions du rapport sont particulièrement alarmantes puisqu’il est indiqué que la direction n’a pris aucune mesure pour prévenir la survenance d’agissements de harcèlement sexuel et d’humiliation, dont la pratique était régulière et dans l’indifférence du collectif de travail depuis plusieurs années. En effet, « il est admis dans la culture de la DSI (le service dans lequel exerce la plaignante) majoritairement masculine, que l’on puisse insulter une femme parce qu’elle ose mettre en avant sa féminité en s’habillant en robe et en portant des talons. Il est admis qu’une femme doivent subir des blagues sexistes, sexuelles parce qu’il est » normal «, entre hommes, de parler de cela au travail » et que « la culture du » c’est pas grave, c’est pas méchant, ce n’est qu’une blague « a pris le pas sur la dignité et sur l’obligation de respect des lois et des règlements qui régissent notre société. ».
Ce rapport préconisait la mise en place d’une démarche de prévention et d’analyse des risques psychosociaux et détaillait le plan d’action à suivre. La collectivité a mis en œuvre certaines des recommandations, comme une procédure de traitement des signalements toutefois, ces démarches n’ont été engagées que postérieurement au second signalement réalisé par la plaignante et aucun dispositif d’alerte et de prévention n’a permis d’éviter que ces agissements ne se produisent et perdurent pendant plusieurs mois.
En droit, l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique rend obligatoire la mise en place d’un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des violences sexistes et sexuelles.
En vertu de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 (n°2020-256), ce dispositif doit comporter une procédure de recueil des signalements, une procédure d’orientation vers les services et professionnels compétents (vers un psychologue, par exemple) et une procédure d’orientation vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés.
Pour que ce dispositif soit utile, la Défenseure des droits a rappelé dans une décision-cadre publiée le 5 février 2025, qu’une communication régulière sur son existence doit être effectuée auprès des agents. Il faut également communiquer sur les garanties apportées en termes de confidentialité et d’impartialité.
Par conséquent, l’administration a failli à son obligation de prévention et sa responsabilité pour faute est engagée.
II. La prise en charge des faits de harcèlement sexuel: l’obligation de protection de l’administration
A. Comment protéger efficacement les victimes ?
En l’espèce, après que la plaignante a donné l’alerte sur sa situation le 4 décembre 2019, la collectivité de Martinique n’a rien mis en place pour lui venir en aide ou pris des mesures de nature à faire cesser le risque auquel elle était exposée, ce qui a conduit l’adjointe territoriale à être placée en arrêt-maladie.
En effet, concernant l’audition de potentiels témoins, seul un agent a été entendu. Or, il est important de prendre en compte le témoignage de toute personne dont l’audition pourrait s’avérer utile pour éclairer les faits, s’assurer qu’il n’y a pas d’autres personnes ayant subi les agissements incriminés ou encore pour établir des dysfonctionnements. Outre le témoignage de la victime présumée, l’administration doit recueillir les déclarations des collègues de travail (CAA Bordeaux, 5 février 2004, n° 00BX00744).
De plus, aucune mesure n’a été prise afin de séparer la victime de son harceleur et elle a dû travailler avec ce dernier jusqu’à ce qu’elle soit placée en arrêt maladie, à partir du 12 mai 2020, pour traumatisme psychologique et état dépressif réactionnel majeur. Elle n’a pu bénéficier d’un bureau individuel qu’à son retour d’arrêt maladie, son collègue ayant été installé sur un autre site à compter du 12 novembre 2020.
La plaignante a bénéficié d’un suivi par la psychologue du travail à partir du 3 juin 2020 et s’est vu accorder la protection fonctionnelle. Ses arrêts maladie ont été reconnu a posteriori, au titre d’une maladie professionnelle.
Ainsi, en l’absence de réaction de la collectivité, les faits de harcèlements sexuels ont pu perdurer pendant plusieurs mois après le signalement fait par la victime. De ce fait, l’administration n’a pas su prendre en charge efficacement la victime et a failli à son obligation de protection.
Pour pouvoir protéger efficacement l’agent victime, l’administration aurait dû, dans un premier temps, instaurer une procédure de prise en charge de cet agent.
En effet, une prise en charge immédiate de l’agent doit être faite, à plusieurs niveaux. Une prise en charge clinique tout d’abord. Elle doit être physique, mentale, voire médicalisée, en vue de l’orientation de la personne victime selon son état de santé et son choix d’établissement. Une prise en charge psychologique ensuite, il s’agit d’orienter la victime vers un psychologue, si elle le souhaite. En l’espèce, la victime a été suivie par le psychologue du travail un an après que les faits ont débuté, ce qui est beaucoup trop tardif.
Il doit également y avoir une prise en charge sociale ainsi qu’administrative, il s’agit d’informer la victime sur ses droits (protection fonctionnelle, dépose d’une plainte…), de rédiger un rapport dans le cadre de l’enquête administrative et de constituer, le cas échéant, un dossier d’accident de service ou de travail.
Enfin, il faut prendre en charge juridiquement la victime (information sur la possibilité de se constituer partie civile pour porter plainte, mise en relation avec un avocat, droit de retrait).
Il est essentiel que cette prise en charge se fasse immédiatement après le signalement de la victime.
Dans un second temps, pour protéger la victime, il convient de lui octroyer la protection fonctionnelle. Elle est prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. En matière de harcèlement sexuel, un aménagement de la preuve existe. En effet, l’agent qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle en soutenant avoir été victime de tels faits doit soumettre des éléments de fait seulement susceptibles d’en faire présumer l’existence. (TA Montpellier, 3e ch., 21 fév. 2025, n°2204566)
B. L’attitude à adopter face à la personne mise en cause
L’administration n’a pas adopté la bonne attitude face à la personne mise en cause. En effet, l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique dispose qu’en présence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique, une mesure d’urgence doit être prise sans délai et à titre conservatoire. Ces mesures sont de deux types, la suspension et le changement d’affectation dans l’intérêt du service.
En l’espèce, l’administration a décidé de changer de service le mis en cause en novembre 2020, c’est-à-dire presque seulement un an après le signalement fait par la victime.
Les mesures conservatoires doivent être prises « sans délai » puisque leur objectif est de faire cesser le risque et de prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages.
En réagissant aussi tardivement, la collectivité de Martinique a laissé la situation s’aggraver, conduisant la victime à être placé en arrêt maladie.
Par conséquent, la cour retient que l’administration a manqué à ses obligations de protection de la santé physique et mentale de ses agents et que ces manquements sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Martinique.
Le préjudice moral de la victime a été évalué à hauteur de 5 000 euros.