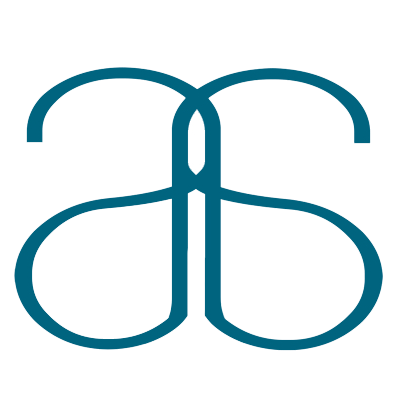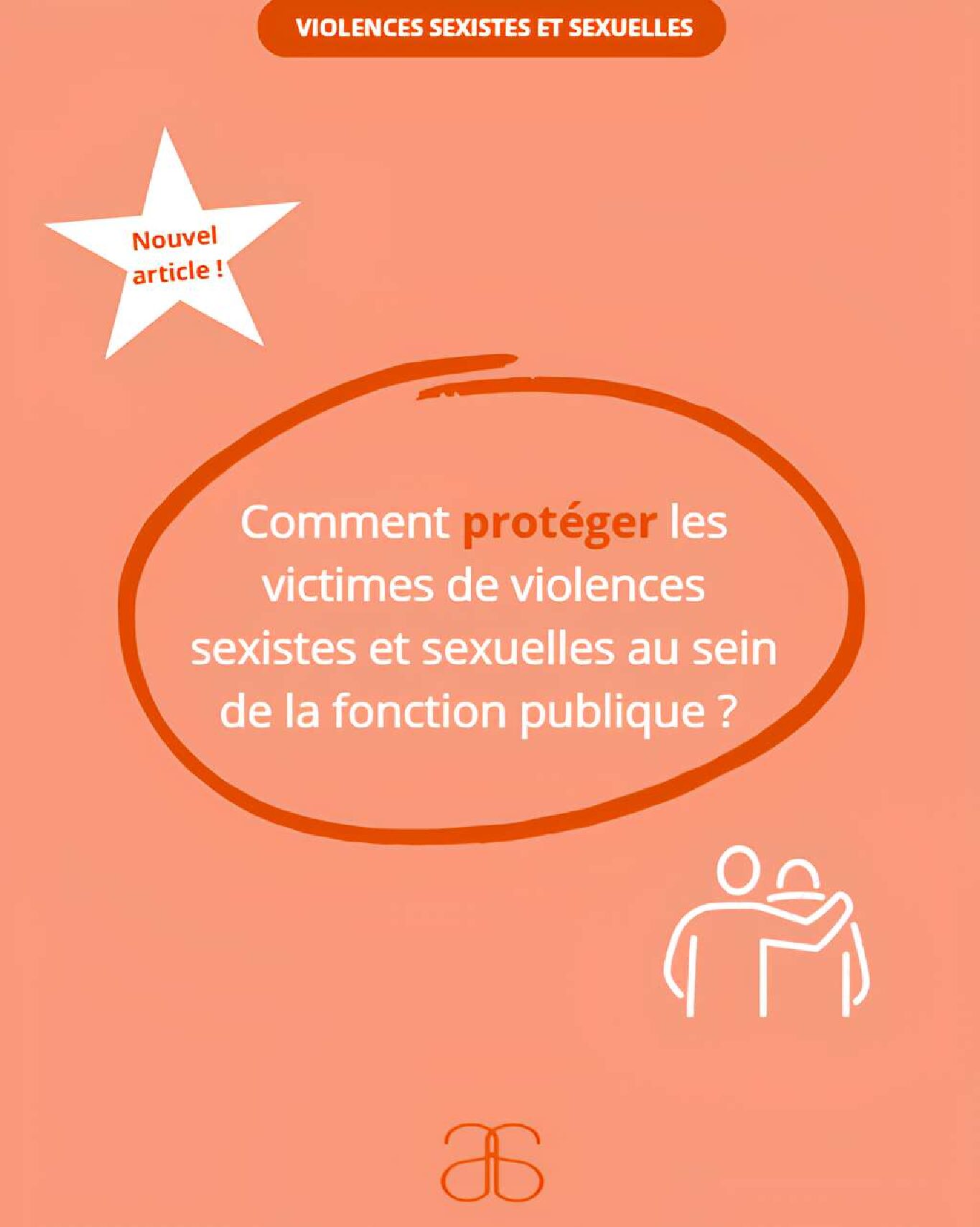Comment protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles au sein de la fonction publique ?
Il ressort de la décision-cadre du Défenseur des droits publiée en 2025 que près de trois victimes sur dix (29%) de violences sexistes ou sexuelles n’en parlent à personne.
Et selon un livret sur le harcèlement sexuel au travail publié par le Défendeur des droits en 2014, 70% des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail ne le signalent pas à leur employeur.
Ne se sentant pas protégée, la victime peut hésiter à dénoncer son agresseur et à demander de l’aide.
Il convient donc de s’interroger sur la protection à accorder à ces victimes. Comment l’employeur public doit-il réagir aux signalements des victimes (1.) et quelle attitude doit-il adopter face à la personne mise en cause ? (2.)
-
La protection de la victime
a) La mise en place d’une procédure de prise en charge de l’agent victime
Tout d’abord, un entretien avec la victime doit être mené par l’employeur public pour recueillir son signalement et évaluer la situation.
Concrètement, il s’agit de recueillir son signalement, d’enregistrer les faits, de dresser un compte-rendu détaillé de ce signalement, des faits qui ont été rapportés, d’informer la victime de ses droits notamment de sa possibilité de solliciter la protection fonctionnelle, des mesures médicales possibles, de la possibilité de déclarer un accident de service (l’agent ne dispose que de quinze jours pour faire une telle déclaration).
Après cet entretien, une enquête administrative doit être lancée.
Ensuite, l’employeur public doit accompagner la victime dans ses démarches médicales. Au niveau clinique, tout particulièrement en cas de viol, cette prise en charge doit être rapide afin que les éléments de preuve soient conservés, les traces et indices préservés. Un examen médico-légal devra être réalisé. Au niveau psychologique, la victime doit être dirigée, si elle le souhaite, vers un psychologue pour qu’elle puisse être écoutée.
Enfin, la protection de la victime implique également une audition des témoins, s’ils existent. Il faut recueillir leurs versions des faits dans des témoignages précis et circonstanciés, leur assurer une protection contre de potentielles représailles et de manière générale, les rassurer afin qu’ils soient libres de livrer leur version des faits.
Cette prise en charge des victimes doit avoir fait l’objet, en amont, d’une réflexion pour qu’elle puisse être facilement mise en place lorsqu’une victime effectue un signalement. L’objectif est d’éviter ce qu’on appelle la victimisation secondaire.
b) Eviter la victimisation secondaire
Comme cela a été rappelé en introduction, 70% des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail ne le signalent pas à leur employeur.
Comment expliquer que tant de victimes prennent la décision de ne pas alerter leur employeur des violences qu’elles subissent ?
Ce chiffre peut s’expliquer par leur crainte quant à la manière dont sera traité leur signalement. Seront-elles écoutées ? Devront-elles faire face à des remarques sexistes, culpabilisantes ? Seront-elles mises à l’écart par leurs collègues ?
Cette crainte est aujourd’hui expliquée par la notion de victimisation secondaire :
La victimisation secondaire a été définie par le Conseil de l’Europe dans une recommandation de 2023. Il s’agit de la souffrance subie par la victime du fait de la réponse des institutions ou de certains individus dans le cadre de la procédure, et non directement de l’acte délictueux. Cette notion a été utilisée pour la première fois par les juridictions françaises dans une décision rendue le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Paris condamnant Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Cette victimisation secondaire a été qualifiée comme un préjudice aggravant distinct, justifiant l’octroi d’une indemnisation spécifique au titre de la dureté excessive des débats.
Dans cette affaire, les juges ont considéré que le préjudice causé à la partie civile, au titre de la victimisation secondaire, a pour origine les propos tenus par le conseil de Depardieu durant le procès. Au-delà de la polémique engendrée sur ce que peut dire ou non un avocat en audience, la notion de victimisation secondaire ne doit pas être restreinte à cette hypothèse (celle d’un avocat qui pense que ses propos peuvent ne pas avoir de limites).
La victimisation secondaire doit être comprise, de manière plus générale, comme étant la double peine que subissent de très nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles : non seulement elles souffrent de l’agression subie mais, en outre, elles sont confrontées à une réponse inadéquate de la part d’individus ou d’institutions qui leur cause une souffrance supplémentaire (considérations stéréotypées, sexistes, des propos moralisateurs ou culpabilisants, procédure judiciaire d’une longueur excessive …).
Prenons l’exemple d’une fonctionnaire qui subit des attouchements de la part d’un collègue. Si elle n’ose pas dénoncer celui-ci auprès de sa hiérarchie qui s’est elle-même illustrée en tenant des propos misogynes, alors cette fonctionnaire souffrira à la fois de l’agression sexuelle et du silence que l’attitude de sa hiérarchie lui impose implicitement.
Pour bien comprendre la spécificité de cette problématique, il faut imaginer que cette même fonctionnaire ait été victime du vol de son téléphone portable au sein de son service. Elle n’aurait assurément pas redouté d’en parler à sa hiérarchie. Il est en effet peu probable que celle-ci lui aurait répondu qu’elle l’avait bien cherchée parce que son téléphone avait une coque bien trop belle ou parce que le vol d’un portable, ce n’est rien du tout. Donc il est souvent bien plus facile de dénoncer un vol de téléphone qu’une agression sexuelle !
C’est pour cette raison que la reconnaissance de la notion de victimisation secondaire est essentielle en matière de violences sexistes et sexuelles et que pour éviter cette peur et permettre aux victimes de dénoncer librement leur agresseur sur leur lieu de travail, il faut que l’employeur public mette en place une procédure de prise en charge des victimes qui soit réellement protectrice et efficace.
c) L’octroi de la protection fonctionnelle
Le Code général de la fonction publique prévoit que la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, contre les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les injures, les diffamations et les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle ne puisse lui être imputée.
En matière de harcèlement sexuel, l’agent public qui sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle en soutenant avoir été victime de tels faits doit soumettre des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence.
Dès lors que les conditions légales sont réunies, la protection fonctionnelle présente un caractère impératif et ne peut être refusée que pour des motifs d’intérêt général dûment justifiés (CE, 14 février 1975, n°87730), ou en cas de faute personnelle de l’agent détachable du service (ce qui est peu probable pour la victime de VSS).
Par conséquent, le refus de protection fonctionnelle ne reposant sur aucun motif d’intérêt général est illégal. Cette illégalité engage la responsabilité de l’administration qui pourra être condamnée à indemniser l’agent (CE, 17 mai 1995, n°141635).
S’agissant de l’instruction de la demande de protection fonctionnelle, s’il s’avère que l’agent mis en cause par la victime est également l’autorité qui a la compétence pour se prononcer sur l’octroi de la protection fonctionnelle, il ne peut régulièrement statuer sur cette demande et doit la transmettre (CE, 29 juin 2020, n°423996).
La protection fonctionnelle dont bénéficient les agents victimes recouvre plusieurs aspects :
- Une obligation de prévention ;
- Une obligation de réparation : qui inclut par exemple, la prise en charge des frais médicaux exposés en raison de la situation justifiant le bénéfice de cette protection si le requérant apporte la preuve de frais restés à sa charge. (TA Toulouse, 2e, 6 juin 2024, n°2201438)
Il s’agit d’apporter à l’agent une aide dans les procédures juridictionnelles engagées, notamment devant les juridictions pénales. Cette assistance juridique peut se manifester par la prise en charge des honoraires d’un avocat par l’administration.
L’agent demeure néanmoins libre du choix de son avocat. S’il n’a pas fixé son choix sur un défenseur en particulier, l’administration pourra, si l’agent en exprime le souhait, l’accompagner dans sa décision.
> Est-il possible d’octroyer la protection fonctionnelle en l’absence de décision pénale définitive ?
L’absence de décision pénale définitive et de conclusions de l’enquête administrative ne font pas obstacle à ce que la protection fonctionnelle soit accordée à l’agent victime. Ainsi, le tribunal administratif de Nantes a récemment jugé que l’administration n’avait qu’à mettre fin à la protection fonctionnelle pour l’avenir si elle constatait au regard de nouveaux éléments que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies (TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2024, n°2102154).
-
L’attitude à adopter face à la personne mise en cause
S’il y a un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique, des mesures d’urgence doivent être prises sans délai et à titre conservatoire (article L. 134-6 CGFP). Ces mesures doivent permettre de faire cesser le risque et prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages.
Ces mesures sont de deux types : la suspension de la personne mise en cause et le changement d’affectation de la personne mise en cause dans l’intérêt du service.
La suspension du mis en cause à titre conservatoire est une mesure temporaire et conservatoire prise sur le fondement de l’article L. 531-1 CGFP. Elle ne peut être prononcée que pour une durée de quatre mois au maximum.
Le changement d’affectation du mis en cause dans l’intérêt du service est une mesure de mutation qui doit être envisagée uniquement en considération de l’intérêt du service. Elle doit donc être fondée sur des critères objectifs. Elle ne doit pas être prise par volonté de sanctionner, il s’agirait dans ce cas-là d’une sanction disciplinaire déguisée.
- Quid de la présomption d’innocence ?
La procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué (CE, 10ème et 9ème ss-section réunies, 7 nov. 2012, n°348771).
- Faut-il accorder la protection fonctionnelle à la personne mise en cause qui en fait la demande ?
En vertu de l’article L.134-4 du code général de la fonction publique, lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder la protection.
Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable du service les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, ou qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonction publique ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis revêtent une particulière gravité (CE, 30 décembre 2015, n°391798) ; CE, 29 décembre 2021, n°434906)
Pour les faits de violences sexistes et sexuelles, a priori les trois critères apparaissent alternativement remplis et un refus de la protection fonctionnelle est envisageable, mais il convient d’être prudent, d’analyser chaque situation au cas par cas.
Ainsi, s’il n’y a aucun témoignage sur les faits et que rien ne vient corroborer les faits avancés, il peut être plus prudent d’accorder la protection, car la responsabilité de l’administration pourrait être recherchée pour refus de protection si finalement il est démontré que les faits allégués n’ont pas eu lieu.
De toute manière, si l’agent mis en cause est finalement condamné, il sera possible de retirer la décision d’octroi de la décision accordant la protection fonctionnelle. (TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2024, n° 2102154).